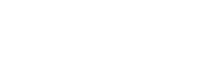
|
Keith Haring jusqu’au 29/06 au Musée d’art contemporain, Cité internationale, 81, quai Charles-de-Gaulle, Lyon (69).

Keith Haring, Untitled, 1981, Enamel and dayglo on metal. © Estate of Keith Haring, New York
< 28'03'08 >
Keith Haring sous toutes ses coutures
(Lyon, envoyée spéciale) « Mes peintures sont l’enregistrement d’un laps de temps […] Mon art définit et expérimente l’espace. Il change l’espace et peut faire partie de n’importe quel espace. » Keith Haring, « Journal », octobre 1978. Une rétrospective-événement Jusqu’en juin, le Musée d’art contemporain de Lyon, dans l’intégralité de ses trois étages d’exposition, accueille une rétrospective de l’œuvre de Keith Haring, la première de cette ampleur tant en Europe qu’aux Etats-Unis (où très peu de peintures de Haring ont été achetées par les musées). Une exposition-événement – organisée en collaboration avec la Fondation Keith Haring de New York – qui vise, avec une ambition revendiquée, à montrer toutes les « zones » d’inscription du trait fluide, à la fois simple et labyrinthique de l’artiste. Tout est là, ou presque, sinon montré sous forme de vidéos ou par la photographie : les « subway drawings » à la craie blanche réalisés dans les couloirs du métro new-yorkais, les dessins au marqueur noir, les peintures aux grands aplats de couleurs fluo exécutées sur bâches, les fresques (murales ou sur plaques de métal), les sculptures monumentales, et les Pop Shop qui valurent à Haring tant de critiques en raison de leur apparente visée commerciale. Il ne manquait à la prolifique production dessinée/peinte de Keith Haring, à cette œuvre ouverte, « gravée » dans les réalités urbaines du New York des années 80, inscrite dans la culture underground visuelle et musicale de SoHo et de l’East Village, que l’« expérience » des surfaces circonscrites, codées et scénographiées de l’institution muséale contemporaine, un « ailleurs » pour cette œuvre qui vécut de et dans l’espace public, sur ses surfaces les plus exposées, les plus populaires et les plus communicatives. Naissance d’un langage graphique Cette exposition est une rencontre de surfaces et d’espaces, articulée en un parcours moins chronologique des formes et des supports investis par Keith Haring que comme une montée en puissance d’un langage graphique et symbolique. Une confrontation entre le musée et une œuvre que l’on pourrait définir de « non-muséale », qui change notre regard sur celle-ci et rend aiguë son unité formelle et iconique, ainsi que sa réelle inscription dans l’histoire de l’art moderne. Ses premières surfaces d’expérimentation artistique, Keith Haring les trouvent à New York où il s’installe en 1978, à l’âge de 19 ans, pour suivre les cours de la célèbre School of Visual Arts (il a, entre autres, pour enseignant l’artiste conceptuel Joseph Kossuth). Le lieu : le métro. Le support : de grands panneaux noirs, inutilisés, en attente d’un affichage publicitaire. Haring investit ces espaces provisoirement « vierges », parce qu’ils ont une fonction de communication, qu’ils sont destinés à être vus par tous, qu’ils ont un format déterminé. Le dessin se fait à la craie blanche. Le trait est continu, en un geste qui, dans le temps, ne s’interrompt pas tant que la surface noire n’est pas « occupée » – mais jamais jusqu’à saturation, tout doit rester lisible, accessible. Haring produit un trait et un geste publics dans l’histoire même de la ville. Ce sont donc les « subways drawings », éphémères, usurpés à l’espace commercial urbain, qui le feront connaître. Nous ne voyons de ces « subway drawings » que la trace, grâce à des photographies en grand format, Haring considérant l’exécution de ces dessins volés comme une performance et il se faisant photographier à chaque intervention… Apparaissent sur ces premières œuvres, les figures iconiques qui traverseront toute la production de Haring jusqu’à sa mort en 1990 : les personnages hybrides entre figuratif et conceptuel, les formes animales entre chiens et loups, inquiétantes et étranges, les soucoupes volantes, les Mickey détournés (l’artiste a été formé au dessin expressif et narratif de la bande dessinée par son père)… Et puis, le célèbre « Radiant Baby ». Peinture de rue Le métro, et puis la rue, avec ses murs laissés en friche, où Keith Haring entreprend d’immenses fresques, la plupart réalisées avec des enfants. Pas uniquement à New York, mais aussi à Sydney, à Rio, à Amsterdam, à Pise, à Paris (pour l’hôpital Necker), à Berlin (sur le Mur). De tout ce travail mural, nous voyons un long film vidéo mais surtout, et c’est probablement l’un des temps forts de cette rétrospective – toujours sur le principe de la fresque –, l’accrochage d’une impressionnante frise faite de larges plaques de métal de récupération, retrouvées par hasard en France. S’y déploie une histoire infinie, complexe avec des personnages traversés, transpercés, troués d’un cercle rouge ou marqués d’une petite croix rouge, aussi. Personnages souples, presque mous, en état de chute ou de tentative d’ascension, ou à quatre pattes cloués au sol. Personnages irradiants ou en danger. Et puis, il y a ce cœur rouge sur le ventre d’une figure féminine. Une fresque en noir et rouge qui donne à voir toute l’angoisse de la vie et de la mort. Lorsqu’il décide de la peinture, Keith Haring choisit un matériau industriel ordinaire, pas cher : des bâches en vinyle, des bâches de camion, des toiles goudronnées. Il y trouve de nouveaux formats. L’exposition « regorge » de ces peintures. Les couleurs y sont vives, tranchées, fluo. S’y retrouvent les figures récurrentes, celles des « subway drawings », celles des fresques murales, celles de la frise. Jusqu’aux grandes bâches des dernières salles, sombres et hantées par la mort imminente. Il y a cette figure du serpent avec laquelle Haring représente le virus du sida contre lequel il se bat. Symbolique simple, compréhensible par chacun de nous. C’est ce que voulait Haring : un art pour tous et accessible à tous. Dans la forme, dans la représentation et par le support. Le dehors au dedans L’art du XXe siècle – on le sait depuis Walter Benjamin – est reproductible. Avec la création des Pop Shop au milieu des années 80 (à New York et Tokyo), boutiques de produits dérivés de ses œuvres graphiques, Haring applique la leçon. Tee-shirts, baskets sont aussi des surfaces graphiques, multiples et mobiles. Le produit dérivé, reproduit industriellement, est ainsi conçu comme un transport plus large et plus universel de l’art. Le Pop Shop de Tokyo est reconstitué dans l’une des salles de l’exposition. On y entre avec des chaussons ! Œuvres dans l’espace public, les peintures, les dessins, les graffitis de Haring ont été exposés : dès 1982, à New York, au mythique Club 57 où se retrouvait l’avant-garde artistique et musicale ; en galerie également, celle de Tony Shafrazi. L’importance, aujourd’hui, de la rétrospective de Lyon, c’est qu’en réunissant autant d’œuvres réalisées pour des lieux du dehors, elle offre la possibilité d’avoir un regard d’ensemble, de percevoir des symboliques et des thèmes, de toucher des filiations, des références dont Haring lui-même s’est fait l’écho, notamment dans ses journaux intimes. Il s’est ainsi longuement exprimé sur le choc que fut pour lui la découverte de Pierre Alechinsky, l’influence importante également de Jean Dubuffet, a souligné ses emprunts qui vont de Jackson Pollock à Donald Judd, sa dette envers les grands noms du pop art : Lichtenstein et Warhol. D’autres correspondances se dessinent à la vision de ses « tableaux » : la ligne « haringienne » puise sa source chez Matisse, Miro, Paul Klee (pas tant dans le trait graphique que dans l’apposition d’une multitude de signes symboliques qui ponctuent la surface peinte). La rencontre d’Haring, cet artiste du dehors, avec le musée, c’est ce moment où l’œuvre s’unifie, se complexifie aussi, mais sans oublier qu’elle fut au cœur d’une vie généreuse, fulgurante et brève. Ne jamais oublier le cœur rouge que Haring ne cesse de peindre.
< 1 >
commentaire
écrit le < 22'05'08 > par <
trash cNq technart.net
>
Voilà maintenant qu’il n’est plus on peut l’entasser dans un musée. J’ai trouvé la scénographie ridicule (on confronte dites vous ?). Les médias apportés et disposés dans des écrans 16/9 sont passés écrasés. Si le football a pu supporter ce traitement, pourquoi pas l’art contemporain me direz-vous ! Passons. Le documentaire posthume diffusé à la fin de l’exposition ( moyennement bien fait) arbore des sous-titre truffés de fautes d’orthographe [bla bla bla] J’ai été très mal accueilli à l’entrée.... [bla bla bla] bref, j’étais vraiment très déçu de voir que comme le cinéma, il se pouvait que la culture s’en tienne à l’idée qu’on pouvait se faire des choses. La bande annonce est réussie. Le film est nul même si les acteurs sont bons. Et ce qui est magnifique c’est que la critique est contente. 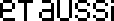
L’icône Susan Kare
L’IA n’a pas halluciné cette Papillote Episode 5 : comment on exposait avant (encore !) ? La Place forte, l’appel de Vincent Elka Lokiss On vote pour TOUT ART CONTRE LA GUERRE Nîmes, deux jeunes artistes à revers 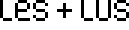
|