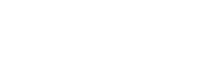
|
Rencontre avec l’écrivain William Gibson lors de son passage à Paris pour le Salon du livre pour la sortie de son livre « Code Source » (éd. Au Diable Vauvert).

William Gibson, 60 ans, après avoir exploré le futur, se colle aujourd’hui au présent ou au passé très récent. © DR
< 20'08'09 >
William Gibson : « Le futur n’est plus nouveau »
(Pop’archive).
Cyberpunk et auteur de SF visionnaire, William Gibson, l’inventeur du terme cyperespace au début des années 80, utilise désormais ce qu’il appelle sa « boîte à outils » d’auteur de science-fiction pour évoquer notre passé très récent. Rendez-vous était pris avec l’auteur américain à l’occasion de sa venue au Salon du livre pour discuter de son dernier roman, « Code Source », dont la traduction française vient de paraître (éd. Au Diable Vauvert). Pour poptronics, il revient sur ses méthodes de travail, son intérêt pour les artistes qui utilisent les technologies, l’écriture et la lecture au temps des moteurs de recherche. Avec « Code Source » comme dans votre précédent ouvrage, Identification des schémas, vous quittez la fiction au futur pour vous intéresser au présent, qui aurait dépassé selon vous l’imaginaire de la science-fiction. Comment réagissez-vous en tant qu’écrivain ? Le futur est un ensemble de constructions culturelles et nous sommes dans une impasse. La biosphère survivra-t-elle ? Comment faire des prédictions responsables ? Comment construire le futur ? La bizarrerie même d’être en vie... Certaines informations en 2008 sont de la science-fiction alors que d’autres sont traditionnelles. J’ai un ensemble d’outils hérités de la science-fiction qui me sont très utiles pour décrire la réalité. Par exemple, avec mon outil « Blade Runner », chaque futur consiste pour la plus grande partie en son propre passé. Dans la littérature de science-fiction que je lisais jeune, le futur était envisagé comme quelque chose de nouveau, il n’y avait aucun passé. Vous évoquez le « speculative presentism » (une approche spéculative du passé à travers le filtre du présent), futur ou passé... Est-ce votre nouvelle source d’inspiration ? Quand j’ai commencé à écrire au début des années 80, j’ai conçu une sorte de mètre-étalon de la bizarrerie que j’ai utilisé pour six romans. Mais, au moment de « Tomorrow’s parties », c’était à peine adéquat pour ce qui se passait à la télévision. Pour ces deux derniers ouvrages qui se passent plus ou moins dans le présent, je peux utiliser les mêmes outils. Pour écrire sur le futur, il faudrait une nouvelle règle, ce qui n’est pas une mince tâche à élaborer. Je vais m’y atteler un de ces jours, ne serait-ce que pour satisfaire ma propre curiosité.
En ce qui concerne le passé, l’histoire est aussi une discipline spéculative. Elle change en permanence, au fur et à mesure que nous la réécrivons. Pour savoir comment le monde a changé dans le futur, il nous suffirait de regarder un manuel d’histoire à destination des enfants. Vous dites écrire en gardant à l’esprit que vos lecteurs ont Google à côté du livre ouvert... Google est une des rares choses réellement nouvelles, sans équivalent dans le passé. Chaque texte est du coup devenu un lien hypertexte, connecté à toutes sortes de possibilités. Certains lecteurs cherchent tout dans Google. Je suis très conscient de tout ce que je mets dans mes livres, également que les lecteurs vont tomber sur mes traces. J’aimerais créer des pages web qui seraient la seule réponse possible à une requête sur un bout de mon livre. Ce qui est un peu le sujet d’« Identification des schémas ». Je me suis rendu compte récemment que si Youtube avait eu le succès qu’il a actuellement à la sortie d’« Identification des schémas », le livre aurait été reçu de manière très différente. C’est vraiment une vision pré-Youtube. Certains lecteurs ne sont pas disposés à prendre comme acquises les références littéraires. Quand je lis, je consulte un dictionnaire, pas une bibliothèque. Mes lecteurs consultent maintenant Wikipedia. Comment en êtes-vous venu à écrire sur les artistes du locative media dans « Code Source » ? Il y a toujours eu des personnages d’artistes dans mes livres, j’en connais beaucoup et je me suis toujours efforcé de leur donner une carrière réaliste.
Pour ce livre, j’avais envie d’inventer une forme d’art. Je n’arrêtais pas de tomber sur des exemples de locative art que je trouvais extrêmement conceptuels. Je voulais quelque chose de plus viscéral, de plus street art, plus proche du graffiti, un graffiti qui passerait de la grille de la ville à celle du GPS. J’ai essayé d’imaginer ce que serait une ville où il y aurait ce type d’art partout, cette vision s’est révélée trop complexe, mais peut-être je la décrirais dans un autre livre. J’aimerais faire un court métrage où l’on verrait animés tous les paquets d’informations qui sont échangés dans un bout de rue, leur volume énorme. J’espère que quelqu’un va faire ça avant moi. « Code Source » est peuplé de choses invisibles. A la grille spatiale du GPS, vous ajoutez une grille que l’on pourrait qualifier de fonctionnelle avec la présence des orishas (les divinités de la Santeria, version cubaine du vaudou haïtien) qui accompagnent Tito, un de vos personnages. Oui. La présence des orishas dans le livre est en partie d’ordre ethnographique. C’est aussi assez ironique d’avoir un personnage dont les initiatives sont basées sur la foi, comme le décriraient des conservateurs. Et comme il n’y a pas de texte sacré pour la Santeria, j’aimais aussi beaucoup l’idée que la foi de Tito ne puisse être fondamentaliste. Est-ce que, pour vous, les artistes sont le laboratoire du capitalisme ? Oui, les artistes de la bohème étaient l’inconscient créatif du capitalisme, ce n’est ni nouveau, ni une perversion. Par contre, l’idée que les artistes puissent gagner leur vie sans mécène est relativement nouvelle. C’est déjà acquis pour la musique et cela changera avec les livres. La technologie pour les livres n’est pas encore là : aucun matériel de livre électronique n’est encore satisfaisant, il faudrait que ça procure la même sensation qu’un vrai livre, que ce soit fin et flexible des deux côtés. On a aussi besoin de meilleurs modèles économiques. J’ai vu un exemple récent dans Boing Boing : pour un jeune écrivain ou musicien, 1000 fans donnent 100$ chacun par an. Ce ne sont plus de vieux mécènes riches mais de nombreux fans obsédés. Cet article a été initialement publié le 25 mars 2008.
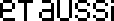
Alain Damasio, un écrivain se prend au jeu (2/2)
Une Papillote dans la matrice cyberféministe de VNS Matrix J.G. Ballard, The Vanishing Point (2/2) Papillote à l’âge du Faire « Poptronics » sur papier se lance à la Gaîté lyrique Série Au(x) monde(s) - Jacques Perconte (1/2) PopAntivirus#6 Échanger pour changer David Guez au futur antérieur « Code Source », la SF en GPS de William Gibson 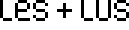
|