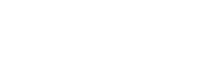
|
Après-coup sur la Frieze Art Fair (qui s’est tenue du 15 au 18/10), la foire d’art contemporain londonienne qui donne le "la" sur le marché : alors, crise ou pas crise ?

Les mots-clefs sous tente du Vitamin Creative Space, avant-première des boutiques Vitamin à venir en Chine. © Elisabeth Lebovici
< 21'10'08 >
Retour de Frieze, l’art sauvé de la crise (ouf ?)
(Londres, envoyée spéciale) « Tout vendre, moins vendre, ou ne rien vendre ? » Une certaine anxiété parcourait les rangées de galeries avant et pendant la journée de vernissage de la foire d’art contemporain réputée la plus branchée du circuit, avec ses 150 galeries de tous pays : la Frieze Art Fair de Londres. Oui, ou non, la crise financière allait-elle se manifester dès maintenant dans le monde de l’art ? En début de soirée du mercredi 15 octobre, après un parcours relativement aéré pour la presse et les VIP de la journée, et avant une soirée à touche-touche, sinon au bouche à bouche, pour les invité/e/s aussi comprimé/e/s quoique légèrement plus botoxé/e/ s que la foule souterraine du métropolitain, les jeux, c’est-à-dire les mots, étaient dits. « Yes but no but yes but no » (l’expression est tirée d’un personnage de la série désopilante « Little Britain). Traduisez : oui, la crise a atteint le marché spéculatif des œuvres d’art mais non, les œuvres d’art semblent moins affectées que d’autres valeurs spéculatives. Oui, l’art continue de se vendre mais non, pas comme avant. Soulagement On entendit une fois, puis deux, puis trois, puis quatre répéter le même type de phrase attribuée à différents marchands : « Les collectionneurs prennent le temps de la réflexion. Ce n’est plus l’achat minute. Les ventes se font plus lentement. Contrairement aux précédentes années, ils ne se ruent plus sur les œuvres en essayant d’enlever la vente avant les autres. Ils sont moins boulimiques et achètent une œuvre à la fois. Ils reviennent. “Je vais réfléchir” l’emporte sur “je prends”… » Le discours des galeries comme des médias aura donc été un discours de soulagement. Soulagement par rapport à ce qui apparaît rétrospectivement comme une « folie » du marché et soulagement par rapport à ce qui serait apparu comme un désastre : la disparition du marché de l’art contemporain. En d’autres termes, comme l’ont écrit les correspondants sur place de « The Artnewspaper » : les achats se sont ralentis mais ce n’est pas pire que ce qu’on avait pu imaginer. Ainsi le communiqué de la Frieze en date du 20 octobre, fait un état des lieux où les ventes ont « dépassé les espérances » et se sont déroulées jusqu’à la fin de la foire, dimanche soir. Voilà le message officiel. On a dit, aussi, que les Américains ont été moins nombreux au rendez-vous, autant dans les rangs des collectionneurs, que dans ceux des « conseillers » ou conseillères de tous acabits qui achètent à leur place. Tant pis, ceux-là furent artistiquement remplacés, avec bonheur, par les extraordinaires doubles portraits de Cindy Sherman, laquelle se met actuellement en images, sous forme de mascarades de la féminité contemporaine, réfléchissant son grotesque en miroir à ceux ou celles qui désirent l’acquérir. Un main, un œuf crevé, un collage et des béquilles Qu’est-ce qu’on a aimé à la Frieze ? D’abord, chez Cabinet, dans une relative obscurité, à la fois du lieu et des objets présentés (découpages, collages, stoppages, pochettes de disques, enregistrements, images…), l’installation mystérieuse du « performer » Tris Vonna-Michell inspiré par le livre de Pierre Klossowski « La Monnaie Vivante ». Et puis, dans le genre de l’intervention, le tract quotidien de Sharon Hayes, distribuant quelques phrases, un fragment de discours amoureux et un méchant morceau d’actualité. Chez Thomas Dane Gallery, les deux grandes peintures du Jamaïcain Hurvin Anderson, qu’on avait vues dans l’expo Archipeinture à Paris. Le silence d’une main blanche, tenant un œuf crevé, l’ensemble par Charles Ray, non loin de trois pièces piégeantes et troublantes de Robert Gober. L’implantation sous tente et les « mots clefs » ou les « objets clefs », des produits du Vitamin Creative Space, de Guangzhou et bientôt de Pékin. Une sculpture-rideau toute en œufs de plâtre et tensions de la grande sculptrice Maria Bartuszova (1936-1996) chez Rüdiger Schöttle. Une distribution de petites jarres et béquilles en caoutchouc par l’Indienne Sudarshan Shetty. Quelques œuvres très graphiques de l’Américaine Frances Stark chez Greengrassi. Plus fun, le collectif Kling & Bang a opéré la recréation à l’identique du bar déglingue Sirkus de Reykjavik et des performances joyeusement gore d’un trio intitulé Icelandic Love Corporation.
D’autres projets « relationnels » moins inspirés, financés par la Frieze, ont permis, grâce à l’artiste Tue Greenfort, de fumer à l’intérieur de la foire (dans des cubicules transparents recyclant également l’eau de votre sueur ou prélevée dans des déshumidificateurs) ou de se faire masser les pieds sur rendez-vous par l’artiste Bert Rodriguez. Cory Arcangel, lui, a permis, grâce à une loterie à base de barres chocolatées, à une galerie impétrante refusée par la Frieze d’obtenir un stand gratuit. Ceal Floyer enfin, a défini son projet comme l’implantation de petits bouts de cartons -stabilisants ? déstabilisants ?- sous les tables d’un des bars de la Frieze. Satellites contestataires et dé-création Dans le genre des manifestations plus ou moins cyniques de bonne volonté contestataire, on a de loin préféré la Free art fair (la « foire d’art gratuit/libre »), sise à Marble Arch. Enfin, dans le cadre de la Frieze, on peut retenir l’entreprise de « dé-création » littérale agencée par la Fair gallery : une « joint venture » à quatre, entre la gb agency de Paris, Jan Mot de Bruxelles, Hollybush Gardens de Londres, et Raster de Varsovie, qui ont décidé de produire un projet d’exposition commun dans les foires. Cette année, il s’agissait de défaire plutôt que faire, sous la houlette du commissaire Pierre Bal Blanc, qui a réussi à convaincre des artistes comme David Lamelas, Pia Rönicke, Deimantas Narkevicius, Dominique Petitgand ou Pratchaya Phinthong. Décréer, c’était ici retourner l’œuvre à son état antérieur, au monde physique ou symbolique d’où elle provient, de revenir au « langage commun », aux sources matérielles, à l’idée première, et de munir cette reversion d’activité artistique d’un certificat d’expropriation de leur auteur en cas de vente. Implacable, pour conclure.
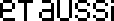
Cybernétique en papillotes
Loop : chambres avec vues sur l’art vidéo « Exit » le cinéma, par ici le « Home Cinéma » à Créteil L’art et la jeunesse insufflent du neuf dans l’édition numérique Papillote en antidote contre le confinement Thomas Houseago sculpte des sentinelles de lumière 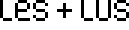
Un Reading Club pop avec Grégoire Chamayou, Isabelle Sorente, Philippe Aigrain, Sophie Wahnich et Mathieu Triclot
« Clubbing » au Grand Palais immersif : alors on danse ! Papillote infuse un brin de permaculture dans le jeu, l’art et les réseaux David Guez « expérimente sans attendre » avec les éditions L « Clubbing », clap de fin avec Pierre Giner : « On pouvait vivre la nuit le jour. Et c’était beau ! » |